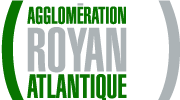Questions/réponses sur l'érosion côtière
Présentation de la conférence du mercredi 15 octobre(102 pages ~ 9 Mo)
Lors de la conférence du 15 octobre 2025 "L’érosion côtière en pays royannais", les auditeurs avaient la possibilité de poser des questions directement depuis leur portable. Nous les avons toutes recueillies et voici les réponses que nous y apportons.
1 - Les phénomènes en jeu étant souvent non linéaires, n'y a‑t‑il pas une probabilité significative d'une évolution plus catastrophique que ce que donnent les prévisions actuelles ?
Le recul du trait de côte est effectivement non linéaire sur la partie océanique de notre littoral (La Tremblade) où les mouvements sédimentaires sont difficilement prévisibles et où des successions de phases d’érosion et d’accrétion sont observables. Le recul du trait de côte est cependant relativement linéaire (pour un pas de temps long) sur le reste du littoral communautaire, qu’il soit sableux ou rocheux.
Les projections de recul du trait de côte réalisée en 2021 y sont pour l’instant suivies. Les projections de recul du trait de côte sont construites à partir d’un recul annuel moyen (Tx) calculé sur une plage de données la plus étendue possible (en général plus de 50 ans). À cela est ajouté un potentiel recul créé par un évènement érosif majeur (Lmax), qui sert de "marge de sécurité" et qui est à concevoir comme le recul provoqué par une forte tempête à l’approche de la date pour laquelle la projection a été faite.
Ainsi, la méthodologie utilisée pour construire les prévisions de recul prend en compte la non‑linéarité du phénomène. Il reste cependant probable que les projections ne soient pas exactement justes, dans un sens comme dans l’autre. De plus, les effets du dérèglement climatique sont très difficiles à quantifier. Bien qu’il soit certain qu’ils aggraveront le phénomène, il est difficile de dire aujourd’hui dans quelle mesure les projections tiennent compte, autant que faire se peut, de ces effets.
2 - Y a-t-il un moyen de vous transmettre un dessin ?
Vous pouvez transmettre toute information concernant l’érosion côtière qui vous semble utile à l’adresse suivante : b.thomas-baggio@agglo-royan.fr (adresse du chargé de mission érosion côtière).
3 - Et la Coubre ? Est‑il exact que son remplacement se ferait avec une tour ?
L’actuel phare de la Coubre, mis en service en 1905, a été construit initialement à 1800 mètres du rivage. Une telle distance avait été décidée après que son prédécesseur (ainsi que de nombreux édifices temporaires de signalisation du XIXe siècle) ait été détruit par les vagues et l’érosion.
La CARA n’est pas en charge du dossier du phare, qui est géré par le service public des phares et balises (service de l’État) et situé sur une parcelle appartenant à l’État. Il est cependant aujourd’hui de notoriété publique que le phare sera déconstruit en fonction de l’évolution du recul du trait de côte.
4 - Tout ce qui a été présenté pour éviter l’érosion est super, mais j’ai l’impression que cela coûte beaucoup d’argent. Et si on laissait faire la nature ? Que se passerait‑il ?
Une majeure partie du littoral communautaire (près des 3/4) est laissé à l’évolution naturelle du trait de côte. La CARA, dans sa stratégie locale de gestion de la bande côtière (SLGBC), a décidé d’y appliquer le mode de gestion "accompagnement des processus naturels" qui consiste à laisser faire la nature tout en observant et mesurant le recul du trait de côte pour emmagasiner des données très utiles.
Le reste du littoral (1/4), où il a été décidé de fixer artificiellement le trait de côte ou de ralentir l’érosion par des méthodes douces, sont des zones urbanisées où le coût de l’entretien des ouvrages est inférieur au coût que le recul du trait de côte pourrait provoquer. Ces analyses coûts‑bénéfices sont réalisées en amont de tout projet d’aménagement côtier.
Pour répondre clairement à votre question, laisser faire la nature sur la totalité du linéaire côtier de la CARA se traduirait par des coûts bien supérieurs pour la société (déplacements d’infrastructures publiques, rachat de biens mis en péril, etc.).
5 - Pourquoi mettre autant d'argent dans des actions à court terme (rechargement des plages par exemple) plutôt que d'agir directement en proposant des solutions viables à long terme ? Qui vont elles‑mêmes nécessiter beaucoup d'argent.
La seule véritable action permettant d’assurer un risque nul pour le recul du trait de côte sur le long terme est le déplacement des enjeux qui y sont soumis.
Lorsque ces enjeux sont des infrastructures publiques (route, piste cyclable, réseau d’eau, etc.), leur relocalisation, bien que souvent complexe, est envisageable du fait de leur statut.
En revanche, la seule solution qui s’offre actuellement aux collectivité voulant déplacer des propriétés privées est de les racheter pour les déconstruire, ce qui constitue un investissement très important sans possibilités d’amorti.
Le recul du trait de côte est considéré comme un risque prévisible par l’État est n’est donc pas éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs (ou fonds Barnier), comme l’est la submersion marine. Ainsi les collectivités n’ont pas, à ce jour, de solutions financières leur permettant d’assumer les coûts de relocalisation des biens privés. Plusieurs propositions pour financer ces actions ont été faites dans les projets de loi de finances de ces dernières années (par exemple une taxe sur les transactions immobilières ou sur les locations de tourisme) mais elles ont toutes étés rejetées par l’Assemblée.
6 - Est-ce que l’érosion est plus ou moins importante dans l’estuaire ?
Le sable des conches (ou plages de poches) situées dans la partie estuarienne du littoral est virtuellement "piégé" : très peu de sable entre ou sort de ces systèmes quasi‑fermés et les conches sont, dans leur majorité, dans un équilibre stable. Les falaises calcaires, qui sont uniquement présentes sur la partie estuarienne du territoire, ne peuvent que reculer, contrairement aux côtes sableuses qui peuvent parfois connaître des phases d’accrétion. Leur vitesse de recul est estimée à 10 cm/an en moyenne. Ainsi l’érosion est bien moins importante sur la partie estuarienne du territoire, qui est plus abritée de la houle que la partie océanique. Celle‑ci connaît, par endroits, des reculs annuels de plusieurs mètres. Les falaises enregistrent un recul relativement lent mais inexorable et permanent.
7 - Conférence très intéressante. Mais pourquoi la problématique plus globale érosion + submersion n'a‑t‑elle pas été traitée et aussi vu l'importance du projet d'enrochement de Ronce ?
Nous avons la chance, sur le territoire de la CARA, de ne pas avoir de secteurs où l’érosion côtière pourrait entraîner une submersion des zones situées en arrière. En effet, les zones bases à risque de submersion présentes sur le territoire sont toutes situées directement sur le littoral. Traiter le problème de submersion (en érigeant un système d’endiguement comme à Ronce‑les-Bains), permet, dans le même temps, de fixer le trait de côte.
De plus, comme évoqué plus haut, les risques d’érosion côtières et de submersion marines sont traités très différemment par l’État, notamment en termes de financements et de réglementation. Il est donc plus facile pour les collectivités de bien séparer le traitement de ces deux aléas, bien que, vous avez raison, ils puissent parfois être liés.
8 - Pratiquant de sports nautiques, je constate l'envasement au fur et à mesure des années de la grande plage de Saint‑Georges‑de‑Didonne, en particulier au Trier. Les bancs de la béchade et de Vallières semblent de plus en plus apparents. À quoi seraient dues ces constatations ? Un apport de limon de plus en plus important de la Gironde ? Une perte du sable par effet de marée, courants et vents ? Ou les 2 cumulés ? Si ce phénomène continue, cela impacterait l'image et l'économie locale ?
L’envasement observable des plages et bancs de l’estuaire semble effectivement imputable à un apport de plus en plus important de limon par la Garonne et la Dordogne. En effet, l’intensification de l’agriculture et le labourage de plus en plus systématique intensifient l’érosion (continentale cette fois‑ci) des sols agricoles dont les particules transportées par l’eau se retrouvent ensuite dans les fleuves.
En parallèle, l’apport de sédiments plus grossiers (sables) est réduit par la construction de barrages et retenues en amont des fleuves.
9 - L'intervention de la dame du BRGM n'a pas abordé l'érosion continentale. C'est à dire, l'érosion des falaises par l'écoulement des eaux pluviales et souterraines. Exemple de la falaise des Pierrières à Saint‑Palais et de la fermeture du chemin des Douaniers. La CARA est concernée par ce phénomène.
Effectivement, les falaises calcaires du territoire sont fortement soumises à l’érosion par les eaux météoriques. C’est même le premier facteur érosif sur la plupart des falaises du territoire, l’action de la mer se limitant à "déblayer" les débris tombés de la falaise. Mme Martins s’est attaché à présenter les actions mises en places par l’Observatoire de la côte de Nouvelle‑Aquitaine mais tant le BRGM que la CARA sont au courant de l’importance des eaux pluviales sur l’érosion des falaises. Parmi les mesures mises en place pour ralentir l’érosion des falaises, la gestion des eaux pluviales est la plus importante.
10 - Merci pour ces présentations qui montrent l'état de notre trait de côte mais n'apportent pas de solution sauf celles connues. Qu'en est‑il de l'influence des modifications des courants océaniques, de la mise en place d'obstacles artificiels marins ?
Les courants océaniques participent très peu à l’érosion côtière en comparaison des effets de la houle et de la dérive littorale (créée par la houle). Les récifs artificiels dont vous parlez sont mis en place le long de côtes sableuses, à quelques mètres sous la surface, et servent justement à atténuer la force des houles. Le territoire de la CARA ne présente pas, à priori, de secteurs où un tel ouvrage serait bénéfique ou utile. En effet, les côtes sableuses dont l’érosion est en partie provoquée par la houle n’abritent que peu ou pas d’enjeux. De plus, ces récifs artificiels ne sont efficaces que lorsque la profondeur d’eau est peu importante et relativement constante et sont donc le plus souvent utilisés en Méditerranée.
Les méthodes de gestion de l’érosion côtière sont en constante évolution et de nombreuses innovations voient le jour chaque année. La CARA est en veille constante pour se tenir informée de ces évolutions et n’hésitera pas à mettre en place des moyens de gestion innovants si cela est approprié.
11 - Que faire de l'enrochement côtier de La Palmyre qui a fait disparaître le sable et par suite la plage ?
La mise en place d’ouvrage en dur (enrochements, digues, etc.) sur une côte rocheuse se traduit presque systématiquement par l’affaissement voire la disparition de la plage située devant. En effet, ces ouvrages bloquent les échanges naturels de sable entre bas de plage, haut de plage et système dunaire lorsqu’il existe. De plus, ils accentuent fortement l’agitation de la mer à leur pied, ce qui met en suspension le sable, qui est ensuite évacué. Enfin, ces ouvrages bloquent généralement le transit longitudinal du sable provoqué par la dérive littorale et provoquent donc une érosion accrue en aval. Il est très probable que l’enrochement de La Palmyre ait accentué l’érosion de la Grande côte entre La Palmyre et Saint‑Palais‑sur‑Mer.
Cependant, depuis sa construction dans les années 1970 de nombreux biens ont étés construits qui sont désormais protégés du recul du trait de côte par cet ouvrage. Il n’est donc pas envisageable de l’abandonner.
Tout afficher
et aussi... l'agenda